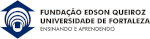La Création en Prison: Un Nouvel élan pour L'existence?
DOI :
https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v17i1.5894Mots-clés :
créativité, prison, existence.Résumé
Comment créer dans l'enfer de la prison ? Se basant sur l'expérience française, les auteurs défendent la nécessité de la création en prison en sept points : 1. La création est un moyen de survie pour échapper à l'effondrement psychique et tenter d'élaborer la souffrance de l'incarcération. 2. Créer amène une évasion par l'esprit et un espace de liberté pour résister à l'infantilisation et à l'abrutissement et ouvrir des horizons dans le temps carcéral mortifère. 3. La création a une fonction d'exorcisme de la haine, de la vengeance, de la violence, de la peur et un effet de catharsis sur la destructivité, évitant qu'elle se retourne contre soi-même et contre les autres. 4. Le travail de figuration, défiguration, reconfiguration de la matière artistique reflète l'ex-pression et l'im-pression de soi, c'est-à-dire les mouvements de transformation de l'être car le détenu est obligé de changer pour survivre et ne pas devenir fou dans sa nouvelle condition de prisonnier. 5. L'artiste qui initie à la création peut devenir un modèle, un passeur, un étayage précieux et la rencontre avec le monde de l'art permet de retrouver des émotions esthétiques qui relient à la communauté humaine. 6. Dans la création collective, la cohabitation forcée et la promiscuité parfois violentes avec les autres peut devenir une aventure collective instauratrice de communauté, voire parfois de fraternité. 7. La reconstruction de soi n'est obtenue qu'à condition de se confronter à sa prison intérieure : le chaos, le malheur, l'indicible, la répétition, les drames de l'enfance, etc. pour tenter de les symboliser et de les transformer. Ainsi, à condition d'être exigeante, la création peut apporter de la hauteur, de la beauté, de la distance, une nouvelle dignité au détenu dans une circonstance où il est en particulièrement privé.Téléchargements
Références
Anzieu, D. (1996). Créer, détruire. Paris : Dunod.
Binswanger, L. (1996). Henrik Ibsen et le problème de l'autoréalisation de soi dans l'art., Bruxelles : DeBoeck Université (Originalmente publicado em 1949).
Bon, F. (1997). Prison. Paris : Verdier.
Broustra, J. (2007). Abécédaire de l'expression. Toulouse : Erès.
Chamond, J., Moreira, V., Decocq, F. & Leroy-Viémon, B. (2014). La dénaturation carcérale. Pour une psychologie et une phénoménologie du corps en prison. L’Information Psychiatrique, 8 (90), 673- 682.
Chapoutot, A. (1993). Les combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis : la liberté selon Gatti. In A. Chapoutot (éd.), L'air du dehors : Pratiques artistiques et culturelles en milieu pénitentiaire (p. 69-73). Paris : Éd. Du May.
Chapoutot, A. (1993). L'air du dehors. Paris : Éd. Du May.
Chartier J.-P., (2015), L’incasable et le psychopathe. Cliniques, (1)9, 132-149
Chouvier B., (2010) La médiation dans le champ psychopathologique. Le Carnet PSY, 141, 32-35.
Cioran, E. M. (1952). Syllogisme de l’amertume. Paris : Gallimard.
Darley, M. & Lancelevée, C. (2016). Faire tenir les murs. Pratiques professionnelles en milieu fermé. Sociétés contemporaines, 3(103), 5-18.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris : Gallimard.
Freud, S. (2010). Au-delà du principe de plaisir. Paris : Payot. (Originalmente publicado em 1920).
Furtos, J. (2008). Les cliniques de la précarité : contexte social, psychopathologie et dispositifs. Issy-les-Moulineaux : Masson.
Gagnebin, M. (1987). Les ensevelis vivants. Des mécanismes psychiques de la création. Seyssel : Éd. Champ Vallon.
Genet, J. (2007). L'atelier d'Alberto Giacometti. Paris : Gallimard (Originalmente publicado em 1963).
Goffman, E. (1968). Asiles. Paris : Minuit.
Hausammann, K. (2010). La création, une question d'acte. Revue Art et thérapie, 84/85. Recuperado de : http://www.inecat.org/extrait-2.html.
Kaès, R. (1979). Introduction à l’analyse transitionnelle. In R. Kaès et. all, Crise, rupture et dépassement (pp. 1-83). Paris : Dunod.
Klein J.-P. (1997). L'art-thérapie, Que sais-je ? Paris : PUF, Paris.
Legendre, C. (1994a). La création, une nécessité vitale. In C Legendre, S. Portelli, O. Maire & C. Carlier, Création et prison (pp 23-30). Paris : L’Atelier, coll. Les champs pénitentiaires.
Legendre C., (1994b) La peinture, un outil thérapeutique ? In C Legendre, S. Portelli, O. Maire & C. Carlier, Création et prison (pp. 153-160). Paris : L’Atelier, coll. Les champs pénitentiaires.
Legendre, C. (1990). Art thérapie en prison, aspects cliniques et réalités pratiques. Soins en psychiatrie, 116(117), 76-79.
Lhuilier, D. & Lemiszewska, A. (2001). Le choc carcéral. Survivre en prison. Paris : Bayard.
Lhuilier D. & Veil, C. (2000). La prison en changement. Ramonville Saint Agne : Erès.
Maldiney, H. (1986). De la Gestaltung. Psychologie médicale, 18(9), 1419-1422.
Marchetti A.-M. (2001). Perpétuités. Le temps infini des longues peines. Paris : Plon, Terre humaine.
Martin, F. (2003). Les ateliers artistiques en prison : créer pour se recréer ? Ban public, Association pour la communication sur les prison et l’incarcération eu Europe. Recuperado de : http://prison.eu.org/spip.php?article3275 .
Morhain, Y. (2012). Paradoxalité de l'enfermement d'adolescents et de jeunes adultes meurtriers : entre destructivité et créativité. Adolescence, 4(82), 797-813
Observatoire Internationale des Prisons. Recuperado de : http://www.oip.org/
Perrault, G. (1993). Procès-verbal de l'inculpé. In A. Chapoutot, L'air du dehors. Pratiques artistiques en milieu pénitentiaire (pp. 45-49). Paris : Éd. du MAY.
Perrault, G. (1991). Point de chute. Isoète : Ecole de la maison d'arrêt de Cherbourg.
Ricœur, P. (1985). Temps et récit. Tome 3. Le temps raconté. Paris : Seuil
Roussillon R., (2010). Propositions pour une théorie des dispositifs thérapeutiques à médiations. Le Carnet PSY, 1(141), 28-31.
Sartre, J.-P. (2000). Huis clos. Paris : Gallimard, coll. Folio. (Originalmente publicado em 1944).
Wacquant, L. (1999). Les prisons de la misère. Paris : Raisons d’agir.
Winnicott, D. W. (1970). Vivre créativement. In Conversations ordinaires (pp. 43-59). Paris : Gallimard, Coll. Folio-essais
Winnicott, D. W. (1967). La délinquance, un signe d'espoir. In Conversations ordinaires (pp. 130-144). Paris : Gallimard, coll. Folio Essais.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés Revista Subjetividades 2017

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Para autores: Cada manuscrito deverá ser acompanhado de uma “Carta de submissão” assinada, onde os autores deverão declarar que o trabalho é original e inédito, se responsabilizarão pelos aspectos éticos do trabalho, assim como por sua autoria, assegurando que o material não está tramitando ou foi enviado a outro periódico ou qualquer outro tipo de publicação.
Quando da aprovação do texto, os autores mantêm os direitos autorais do trabalho e concedem à Revista Subjetividades o direito de primeira publicação do trabalho sob uma licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY), a qual permite que o trabalho seja compartilhado e adaptado com o reconhecimento da autoria e publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores têm a possibilidade de firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada na Revista Subjetividades (por exemplo, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), com o reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores concedem, ainda, à Revista Subjetividades uma licença não exclusiva para usar o trabalho da seguinte maneira: (1) vender e/ou distribuir o trabalho em cópias impressas ou em formato eletrônico; (2) distribuir partes ou o trabalho como um todo com o objetivo de promover a revista por meio da internet e outras mídias digitais e; (3) gravar e reproduzir o trabalho em qualquer formato, incluindo mídia digital.
Para leitores: Todo o conteúdo da Revista Subjetividades está registrado sob uma licença Creative Commons Atribuição (CC-BY) que permite compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar (remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim) seu conteúdo, desde que seja reconhecida a autoria do trabalho e que esse foi originalmente publicado na Revista Subjetividades.